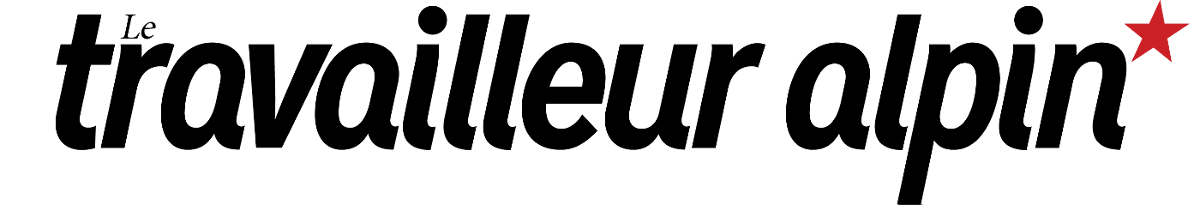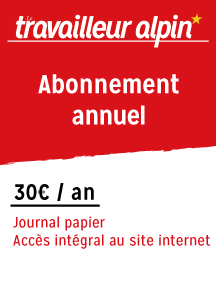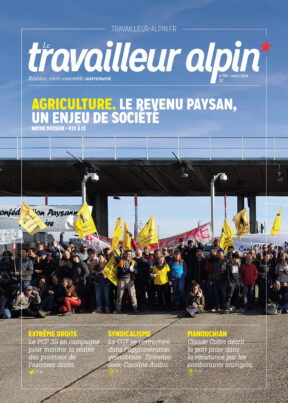Athanor, l’usine d’incinération des déchets de la région grenobloise qui va être reconstruite. Tout comme le centre de tri et le centre de compostage et de méthanisation.
Le traitement de déchets dans le Sud Isère va connaître d’importants bouleversements dans les cinq ans qui viennent. Les trois outils de traitement (incinération, centre de tri et compostage) vont être renouvelés. Ce qui n’enlève pourtant rien aux difficultés actuelles : le niveau de la production des déchets et la qualité de leur tri.
Tout va commencer par le centre de tri. Une nouvelle installation va être construite et c’est un nouveau délégataire, Dalkia, qui sera chargé de la construction et de l’exploitation du nouvel équipement.
La mise en service de ce nouveau centre de tri est programmée pour 2023. Le plus, ce sera l’augmentation de sa capacité : il pourra traiter jusqu’à 51 000 tonnes de déchets par an, contre 41 000 pour l’équipement actuel, construit en 1992. Ce nouveau centre sera implanté à côté de l’actuel, sur la zone Athanor, à la Tronche. Il sera conçu, bâti puis exploité par Dalkia, filiale d’EDF depuis 2014 après avoir fait partie du groupe Véolia. Un changement d’exploitant, puisque le centre de tri est aujourd’hui sous la responsabilité d’une filiale du groupe Pizzorno Environnement – un groupe varois de quatre mille salariés. La chaîne de tri comptera vingt-six étapes, dont quatorze seront réalisées « à la main », par des salariés Dalkia. Le coût de sa construction qui débutera l’année prochaine (50,3 millions d’euros) sera assuré par les sept intercommunalités associées au projet (*).
51 000 tonnes de tri, mais aussi une nouvelle usine pour brûler le contenu des poubelles grises. Le projet de reconstruction de l’incinérateur d’Athanor – géré la Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise, détenue à 52 % par la ville de Grenoble, à 42 % par Dalkia, puis 5 % pour la métropole – a été conçu en 2017. Les travaux devaient débuter en 2020, mais le dossier a pris du retard, faute de pouvoir trouver un candidat à sa construction : l’unique proposition a été jugée trop onéreuse. Aujourd’hui, la mise en route de la nouvelle usine, sur le même site, est annoncée pour 2025. Elle aura une capacité réduite à 155 000 tonnes, contre 185 000 pour l’usine actuelle.
Ces deux équipements seront complétés par le centre de compostage et de méthanisation de Murianette. Là encore, un projet de modernisation est programmé avec, à l’horizon annoncé de 2022, la production de 8 000 tonnes de compost et de biogaz, pour l’équivalent annuel de deux millions de kilomètres parcourus.
Le coût prévisionnel de ces nouvelles installations est de 172 millions d’euros sur le site d’Athanor et 15 millions à Murianette. Sans compter les démolitions des équipements actuellement en fonctionnement sur le site d’Athanor.
C’est la grande distribution qui remplit les poubelles
Reste que ce plan d’ensemble, présenté en 2017, bute toujours sur deux obstacles : la production de déchets et la qualité de leur tri. Ce ne sont pas les usagers qui remplissent leurs poubelles, ce sont les chaînes de la grande distribution. De la bouteille en plastique aux films d’emballages en passant par les conditionnements de meubles ou d’appareils ménagers. Et, de ce point de vue, les collectivité locales sont dépourvues : dans un système économique libéral, c’est « la main invisible du marché » qui est sensée résoudre le problème, mais sa boussole est le profit et non la qualité de vie en société. Les poubelles débordent et la collectivité paie l’élimination des déchets. Deuxième difficulté – plus spécifique à l’agglomération grenobloise contrairement aux idées reçues –, la qualité du tri. Les faits sont là : la qualité du tri ne s’est pas améliorée depuis… 1998. Un tiers de ce qu’on retrouve dans la poubelle grise (en principe, mouchoirs usagés, poussières, bouchons…) devrait être dans la poubelle verte (emballages) et plus de 40 % de ce qui est déposé dans la poubelle verte devrait l’être dans la poubelle grise.
Or, le schéma directeur des déchets à l’horizon 2030 repose sur deux piliers : la réduction du volume de déchets à traiter d’une part et, d’autre part, la diminution des tonnages incinérés grâce à l’augmentation de la part des déchets triés et valorisés.
On en est loin. Au point que, pour faire des économies, la tentation est grande de réduire la collecte des poubelles de tri pour tout incinérer : le traitement d’un déchet déposé dans la verte, rejeté au centre de tri parce qu’il devait aller dans la grise, puis transporté jusqu’à l’usine d’incinération coûte deux fois plus cher que s’il avait été directement stocké dans la poubelle grise.
Une réalité qui questionne les campagnes de communication. La métropole donne le sentiment de préférer la communication de culpabilisation – on se souvient du désastre de l’affichage de personnages emballés – plutôt que d’information… Et l’on se retrouve devant ses poubelles comme une poule devant un couteau.
(*) Grenoble-Alpes métropole, le Grésivaudan, le Pays Voironnais, Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, l’Oisans, le Trièves et la Matheysine, soit 263 communes et 740 000 habitants.

La collecte des emballages plastique n’est pas aisée, eu égard aux volumes de la production de contenants à usage unique.
Et le plastique ? Pollution, production, élimination
Omniprésence des plastiques et problèmes posés par la pollution et les besoins de collecte et de recyclage qu’ils génèrent : des sujets d’inquiétude et de réflexion désormais très présents.
« Peut-on vivre sans plastique ? » tel était le thème du café-débat Sciences et citoyens du mardi 10 mars, qui a réuni une petite centaine de participants.
En introduction, trois présentations par des spécialistes ont pointé
– les liens entre l’image et l’usage : ainsi, après avoir été vécue pendant plus de cinquante ans comme une source de progrès indiscutable, l’utilisation des plastiques pose désormais des questions sur ses effets sur les ressources naturelles disponibles (le pétrole principalement), sur l’émission de gaz à effet de serre (lors de la production et du traitement des déchets) et sur la pollution matérielle de l’environnement, notamment marin, par ses déchets particulièrement non biodégradables ;
– la distinction entre les plastiques à usage long, soit environ la moitié des cinq millions de tonnes de plastiques utilisés en France par an, et les plastiques à usage unique et immédiatement jetés que sont les emballages (bouteilles, récipients, films…) ;
– les avantages et inconvénients des matériaux alternatifs, qu’ils soient connus et utilisés de longue date comme le verre et les métaux, ou objet d’études tels les matériaux « biosourcés ».
Dispositions réglementaires et choix individuels
Les questions de la salle se sont ensuite surtout focalisées sur la « gestion des déchets plastiques », elle-même au cœur du rapport 2018 de l’ONU : comment limiter l’usage des emballages plastique, mieux les collecter, les réutiliser, les recycler ? A été soulignée l’indispensable association des dispositions collectives réglementaires (interdiction de certains usages) ou financières (prix incitatifs) et des comportements individuels de refus ou au contraire de préférence des produits, d’autant plus efficaces que relayés par les médias. La question du tri et du recyclage des déchets, de son coût, voire de sa faisabilité, notamment dans le cas des poubelles collectives, a également fait l’objet de débats.
Et il n’est pas inintéressant de noter qu’en conclusion de ces échanges, la lourde responsabilité, voire le lobbying anti-réglementation, des grands groupes de production et de distribution des boissons en bouteilles plastique (tels Coca Cola, Nestlé…) a été soulignée !
Le recyclage des papiers et des cartons
En France, environ 7,5 millions de tonnes de papiers et de cartons sont collectés et recyclés chaque année, pour un taux passé de 40 à 72% au cours des deux dernières décennies. La collecte auprès des ménages représente en France 52 % du total des papiers recyclés. Le reste provient de la collecte auprès des imprimeurs, de l’industrie et de la grande distribution. Le Centre Technique du Papier (Gières) contribue par ses travaux de recherche à améliorer la filière de recyclage et la qualité des papiers produits à partir de papiers recyclés. Un des enjeux demeure l’harmonisation des collectes au niveau national et un développement de l’économie circulaire ; ainsi certains types de papiers recyclés pourront-ils trouver leur valorisation dans d’autres secteurs industriels.

Une incitation calculée en fonction de la production collective de l’immeuble.
Teomi, la fausse bonne idée
L’incitation par l’argent, c’est tendance. La Métro a annoncé la création d’une taxe incitative, pour l’heure restée dans les cartons. Elle pourrait produire une hausse de l’impôt… pour les particuliers.
Le traitement des déchets, ça coûte cher. 70 millions d’euros pour 2020, soit 280 euros la tonne – chiffres de la métropole grenobloise. Ce budget est alimenté par la vente de matériau issus du recyclage, les éco-taxes, l’énergie produite… Mais l’essentiel reste l’impôt : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom) qui rapportera 52 millions d’euros cette année.
Cette Teom est une ligne qui figure sur la taxe foncière. Elle est donc réglée par les propriétaires – qui la répercutent sur les charges de leurs éventuels locataires – et par les entreprises qui possèdent terrains, bâtiments… Productrices de déchets, elles ont l’obligation de financer leur collecte. Elles paient l’impôt – qui finance des équipements de traitement des déchets, les leurs y compris – et cette collecte spécifique. Leur contribution représente près d’un tiers du rendement de la Teom.
Des entreprises attaquent le service public en justice pour être exonérées de l’impôt, arguant de cette collecte. La jurisprudence est hésitante : les plaignants sont les grandes surfaces qui utilisent les installations de traitement et exportent des déchets chez les particuliers sous forme d’emballages : logique qu’elles paient leur part de l’impôt.
La Teomi, une exonération pour les producteurs de déchets
C’est là qu’intervient la taxe incitative. L’idée, séduisante, est de récompenser ceux qui jettent moins et trient mieux, en réduisant leur impôt. Pour la métro, le chiffre de 20 % de la Teom qui deviendrait taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (Teomi) est évoqué.
Mais voilà. Le montant de la Teomi serait fixé par immeuble. Par définition, il serait variable. Par définition aussi, ce ne pourrait donc plus être un impôt – un impôt est payé par tous dans les mêmes conditions…
Les grosses entreprises qui collectent leurs déchets elles-mêmes ne seraient donc pas concernées par ces 20 % « d’incitation ». Ce qui réduirait leur impôt… et augmenterait d’autant celui des particuliers, commerçants, restaurateurs… L’incitation aux bons gestes se transformerait en impôt supplémentaire.
Sans parler du casse-tête que représenterait le calcul impossible au bas de l’immeuble de qui a trié quoi. Incitation à la délation ?
Verte et grise, le grand mélange
Lorsque une cagette en bois atterrit dans la poubelle des emballages, la verte, elle arrive au centre de tri. Là, elle est sortie du tapis roulant, à la main, par un salarié : une cagette en bois va dans la poubelle grise. Notre cagette est ensuite transportée à l’usine d’incinération. En faisant le détour par la poubelle verte, le coût de son élimination double. Or, la faillite de l’information par la métropole grenobloise sur ce qui va dans telle ou telle poubelle entraîne de nombreuses erreurs de tri. Au point qu’il a été décidé, pour faire des économies, de supprimer la collecte des emballages dans certains quartiers : les contenus de la grise et de la verte partent directement à l’incinération. En attendant que les habitants soient mieux informés ? Dernière précision : le top, pour la cagette, c’est la déchetterie qui valorise le bois.