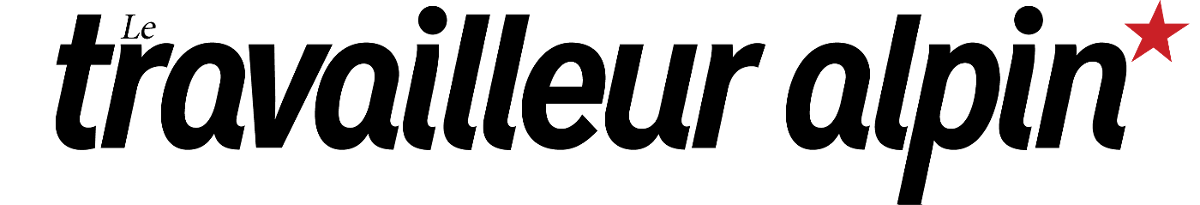« L’Usage du monde », de Nicolas Bouvier
Par Régine Hausermann
/

Nicolas Bouvier n’a que 24 ans, Thierry Vernet deux de plus. L’un écrit, prend des photos. L’autre peint, dessine. Ils ont « assez d’argent pour vivre neuf semaines. Ce n’est qu’une petite somme mais c’est beaucoup de temps. » Et surtout beaucoup de rencontres, de surprises, loin du milieu bourgeois huguenot trop corseté. « Fainéanter dans un monde neuf est la plus absorbante des occupations. »
Cette odeur de melon !
La Yougoslavie d’abord où il y a tant à voir et à sentir. Belgrade et ses faubourgs, les journalistes communistes, les villages de tziganes, la musique et « le kolo, la danse en rond qui fait tourner » tout le pays. Les banquets, la « générosité merveilleuse des Serbes » au point qu’« une salivation émotive accompagne l’appétit ». C’est l’été, les jeunes corps ne sont pas fatigués, la Topolino est en forme. On frôle le bonheur. L’esprit est agile. « Le voyage fournit des occasions de s’ébrouer mais pas – comme on le croyait – la liberté. Il fait plutôt éprouver une sorte de réduction . Privé de son cadre habituel, dépouillé de ses habitudes comme d’un volumineux emballage, le voyageur se trouve ramené à de plus humbles proportions. Plus ouvert aussi à la curiosité, à l’intuition, au coup de foudre. » p.72

La Topolino
Traverser l’Anatolie avant la neige
Constantinople, rive asiatique, c’est déjà la fin de l’été. Les deux garçons sillonnent la ville pour essayer de gagner de l’argent. Il faut songer à repartir vite pour passer avant la neige au col du Cop. Course contre la montre sur la route d’Ankara : treize heures, vingt heures à se relayer. Arrivée à Trebizonde au bord de la mer Noire. Mais pour monter les 3000 m du col, il faut pousser ! « Une petite voiture encadrée par deux coureurs qui la manoeuvrent de l’extérieur, ça retient quand même l’attention. » Effectivement. « Les camions qui venaient d’Erzerum la connaissaient déjà par les récits de ceux qui nous avaient dépassés la veille. D’aussi loin qu’ils l’apercevaient, ils saluaient au klaxon. »
A Erzerum, les belles fortifications ottomanes sont rongées par l’érosion et l’esprit kémaliste est en déclin. Le bakchich comme le clergé sont de retour. Seuls les instituteurs pourraient enrayer le mouvement. « Mais il faudrait douze douzaines de Voltaire ! » L’intense bonheur d’une nuit à la belle étoile les ragaillardit et attire cette réflexion à Nicolas Bouvier : « Finalement, ce qui constitue l’ossature de l’existence, ce n’est ni la famille, ni la carrière, ni ce que d’autres penseront ou diront de vous, mais quelques instants de cette nature, soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l’amour, et que la vie nous distribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible cœur. »
Six mois dans le froid de Tabriz
Les deux garçons s’installent à Tabriz pour l’hiver. Peu d’étrangers dans cette province de l’Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l’Iran. Mais un nœud de religions : shi’ites, arméniens, chrétiens monophysites, juifs venus d’Israël. Comme partout, des riches et des indigents. Novembre, procès Mossadegh : « Pour l’homme de la rue, Mossadegh restait le Renard iranien plus que le Renard anglais, qui avait arraché le pétrole à l’Occident. » Nicolas donne des cours de français. L’hiver n’en finit plus. Thierry commence à craquer. En mars, ils font une sortie vers le sud mais une pluie incesssante les bloque à Mahadan. Plus d’argent. Le capitaine les « invite » à venir se loger à la prison ! Les voilà « hôtes-prisonniers. » Ils apprécient la gaieté des Kurdes victimes de préjugés. « Il faut dire que des influences nombreuses s’exerçaient ici en sous-main : anglaises, russes, américaines, séparatistes kurdes, sans compter la police et l’armée qui ne poursuivaient pas les mêmes objectifs. »

Nicolas Bouvier et Thierry Vernet © Editions Paulsen
Difficile de sortir trop vite d’un récit de voyage, d’un récit de vie, écrit en 1953–54 — année de nos dix ans. Trop à découvrir. Trop à admirer sous la plume d’un jeune homme de 24 ans au moment des faits, de 34 ans au moment de l’écriture. Cette alternance de récit et de descriptions, toujours courtes. Cette prédilection pour les rencontres, la vie des gens, leurs particularités et leur commune humanité. Cette variété des tons : enjoué comme la musique qui irrigue tout le récit, drôle comme tant d’anecdotes et de situations vécues, tragique dans la deuxième partie lorsque les pannes et accidents les rattrapent, poétique souvent, philosophique toujours.
Derniers jours à Tabriz. A la lecture d’Adrienne Mesurat -roman de Julien Green – l’une des élèves de Nicolas Bouvier pense retrouver sa vie. Elle ne s’arrête plus de lire ni de penser. Elle veut savoir ce qu’est l’absurde.
« Pas d’absurde ici… mais partout la vie poussant derrière les choses comme un obscur Léviathan, poussant les cris hors des poitrines, les mouches vers la plaie, poussant hors de terres les millions d’anémones et de tulipes sauvages qui, dans quelques semaines, coloreraient les collines d’une beauté éphémère. Et vous prenant constamment à partie. Impossible ici d’être étranger au monde – parfois pourtant, on aurait bien voulu. L’hiver vous rugit à la gueule, le printemps vous trempe le cœur, l’été vous bombarde d’étoiles filantes, l’automne vibre dans la harpe tendue des peupliers, et personne ici que sa musique ne touche. » p.197
Téhéran, la musique du persan et le bleu de Perse
Sur la route de Téhéran, le moral remonte. Nicolas est sensible à la musique du persan, « chaud, délié, civil, avec une pointe de lassitude ». Il est étonné que l’état lamentable des affaires publiques affecte si peu les affaires privées. A Téhéran, il leur faut trouver du travail. Un entretien rugueux avec le directeur de l’institut franco-iranien tourne au miracle grâce à un fou-rire opportun. Thierry fera une exposition et Nicolas une conférence. Les deux Suisses sont lancés. Téhéran est une ville lettrée. On est étonnée du nombre de personnes rencontrées qui s’expriment en français alors qu’à Paris, personne ne parle le persan ! Les deux garçons font des progrès en persan et communiquent aussi en anglais.
« Et surtout, il y a le bleu. Il faut venir jusqu’ici pour découvrir le bleu. Dans les Balkans déjà, l’œil s’y prépare ; en Grèce, il domine mais il fait l’important : un bleu agressif, remuant comme la mer, qui laisse encore percer l’affirmation, les projets, une sorte d’intransigeance. Tandis qu’ici […] partout cet inimitable bleu persan qui allège le cœur, qui tient l’Iran à bout de bras, qui s’est éclairé et patiné avec le temps comme s’éclaire la palette d’un grand peintre. » p.214
L’Inde, où Thierry doit retrouver son amoureuse, les appelle. La Topolino dont la petitesse étonne toujours les Iraniens est prête. Ispahan tient « exactement l’émerveillement qu’on nous en promettait ». Panne avant l’arrivée à Chiraz. Un camion les embarque avec leur voiture. « C’est dans la première rampe de la descente qu’on entendit péter les freins du camion. » Ils ont failli mourir ! « Quand je repris mes esprits, la poussière était retombée. »

Nicolas Bouvier devant sa machine à écrire
Dans la lumière de braise des tapis usés des« tchâikhanes »
Le voyageur évoque les moments de bonheur vécus dans les « tchâikhanes », ces maisons qui bordent la route, où l’on boit du thé, où l’on se restaure, l’on fait des connaissances, l’on se dit les nouvelles « dans la lumière de braise de leurs tapis usés. » Rares moments où le jeune Bouvier parle du corps des femmes, se dit « ébloui par une servante tzigane. Ce que j’ai vu de plus beau depuis longtemps. Je fais le mort, j’étanche, moi aussi, ma soif en faisant provision de grâce. C’est bien nécessaire ici où tout ce qui est jeune et désirable, se voile, se dérobe ou se tait. »
La route continue vers l’est. Persépolis, Surmak, Yezd, Bam. Le jour, la chaleur est de plus en plus atroce. On les prend pour des fous ! « J’avais souvent pensé au soleil jamais comme à un tueur. » 700 km en seconde dans le désert baloutch ! A la frontière pakistanaise, des soldats les aident à pousser. La panne n’est pas réparée, ils roulent de nuit dans le désert, « seuls sous des milliards d’étoiles ».
Quetta, Pakistan, morts de fatigue
L’arrivée à Quetta — 1800 m, 80 000 âmes, 20 000 chameaux (Pakistan) — est douloureuse : ils ne pèsent plus que cent kilos à deux, ils sont morts de fatigue, toujours en panne malgré dix heures de travail infructueux avec un garagiste. Par chance, Terence, le patron du Saki bar, les emploie pendant trois semaines. De 9 h à minuit, ils jouent javas et valses musette sur leur guitare et leur accordéon. Et la vie change ! Mais les contrariétés ne sont jamais loin. « Plus trace d’artisanat. Portée par une vague majestueuse, l’écume de la camelote occidentale avait atteint et souillé le commerce local : peignes patibulaires, Jésus en celluloïd, stylos-billes, musique à bouche, jouets de fer blanc plus légers que paille. Minables échantillons qui faisaient honte d’être Européens. » La voiture a perdu ses plaques et Nicolas ses notes de l’hiver, emportées par le camion à ordures.
La haine des mouches !
Sur la route de Kaboul, Nicolas s’entaille quatre doigts jusqu’à l’os en réparant le moteur. A Kandahar, un médecin italo-grec le soigne. Le blessé dort trente heures et s’en sort grâce au médecin qui revient chaque jour… et parle français. Fatigue, fièvre… un nouveau combat est déclaré, contre la malaria, et les mouches. « J’aurai longtemps vécu sans savoir grand-chose de la haine. Aujourd’hui j’ai la haine des mouches. Y penser seulement me met les larmes aux yeux. Une vie entièrement consacrée à leur nuire m’apparaîtrait comme un très beau destin. » A Kaboul, les deux amis sont épuisés par la fatigue et la maladie. Ils sont soignés par un médecin suisse, expert aux Nations Unies qui les loge chez lui.
Thierrry prend un avion pour New Delhi. Remis de sa jaunisse, Nicolas part en camion vers la Bactriane pour retrouver des archéologues français.
Le 3 décembre, seul, il quitte le chantier et arrive devant le Khyber Pass – « Devant cette prodigieuse enclume de terre et de roc, le monde de l’anecdote était comme aboli. » p.374
En route pour l’Inde.

The Khyber Pass with the fortress of Alimusjid. Chromolithograph by W.L. Walton after Lieutenant James Rattray, c. 1847. Image : Wikimedia Commons
L’Usage du monde, Nicolas Bouvier, dessins de Thierry Vernet, éditions la Découverte, 384 p.