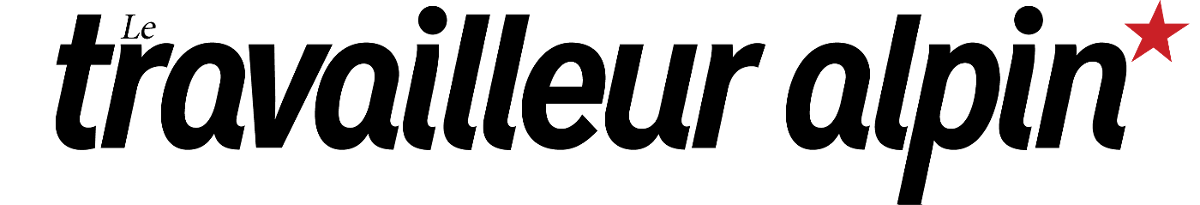« J’entends tout le temps que, mon Bac 2020, on me l’a donné »
Par Luc Renaud
/
Privé de cours à l’université, privé de contacts sociaux... Privé d’avenir ? Pas drôle d’être étudiant aujourd’hui. Ils sont pourtant un certain nombre à ne pas baisser les bras. Parce que le virus n’est pas la cause de tout. Et notamment pas de l’étranglement de l’université et de la recherche. Reportage à l’université de Grenoble.

« Le truc qu’on a à faire dans la vie, c’est juste ça, se coller devant l’écran et rien d’autre ». Ema est étudiante en première année de médecine. Des cours à distance, « des cours mauvais parce qu’il ne peut pas y avoir d’interaction avec les enseignants pour qui ce ne doit pas être simple non plus ». En un mot, « je rêvais d’autre chose, ce n’est pas comme ça que je voyais la fac ». Et puis la démotivation, le lot commun de l’étudiant 2021 : « on est là pour étudier, si on ne peut pas, c’est quand même plus difficile de se lever le matin ». Au point qu’elle connaît des étudiants qui recherchent une aide psychologique. « Au centre universitaire de santé, c’est impossible de voir un psychologue, il faut se débrouiller autrement. »
Ema quant à elle n’est pas vraiment déprimée. Elle fait autre chose dans la vie que l’écran, justement : elle s’occupe que ça bouge. Ce qui ne l’empêche pas de partager les angoisses de toute une génération. « J’ai un bac 2020 et j’entends tout le temps dire que ce bac, on nous l’a donné ». Avec quelle formation, quels diplômes ces étudiants pourront-ils accéder à ce que l’on appelle le monde du travail ? « On y pense tous les jours », appuie Thomas, étudiant en troisième année de licence de philosophie.
Tous deux sont membres de l’Union des étudiants communistes. A ce titre, ils s’investissent dans l’organisation des mouvements qui se font jour à l’université de Grenoble. Dans des conditions difficiles. Ce 11 février, ce n’était pas la grande foule, devant la bibliothèque universitaire. N’empêche : des étudiants de l’UEC, Sud étudiants, l’Unef, l’UEG, des thésards représentant la CGT, d’autres syndicalistes CGT des personnels du centre régional des œuvres universitaires (Crous), une conseillère régionale, Emilie Marche… Ils étaient là avec une revendication simple : des moyens pour que l’université puisse accueillir ses étudiants.
Car la crise universitaire a évidemment été amplifiée par la Covid. Faire les cours à distance, ça demande des investissements pour faire face à une situation d’urgence. Mais la mise à la diète de l’enseignement supérieur n’a pas attendu la Covid. « Ce qui est programmé, c’est la perte de 250 postes d’enseignants chercheurs à l’université de Grenoble », indiquait un doctorant syndiqué à la CGT. Et si l’on veut aujourd’hui que les étudiants puissent retrouver le chemin de l’université, des moyens nouveaux sont nécessaires pour des cours en amphi moins chargés, pour des enseignements par petits groupes, la gratuité des masques et du gel. « C’est pour ça que nous nous battons, souligne Ema, que les facs rouvrent progressivement en lien avec le développement de la vaccination et avec les moyens de le faire ». Difficile en effet de considérer que l’université, la recherche et l’enseignement puissent faire partie des activités « non essentielles »…
Ce monde où des étudiants recherchent de quoi manger
Pour la lutte, les étudiants communistes ont décidé de s’investir dans le collectif « interorgas » qui regroupe également les militants de Sud, de l’Unef et de l’UEG. « Nous nous réunissons chaque semaine », précise Ema. Avec des initiatives comme celle du rassemblement du 11 février – proposé « pour que la manifestation interpro du 4 février ait un prolongement sur le campus » –, mais aussi d’autres comme celle conduites sous l’égide du collectif Génération précarité. « Nous assurons des distributions alimentaires dans les cités universitaires, notamment de fruits et légumes, raconte Ema, en tournant dans les cités, et ça répond à un besoin, tout le monde vient et il n’y en a pas toujours pour tout le monde ». Ce monde d’aujourd’hui où il faut s’inquiéter de l’alimentation des étudiants…
Ema et Thomas n’ont pas que l’action commune comme corde à leur arc militant. « La semaine de la pensée marxiste se déroule à partir du 15 février, note Thomas, c’est l’occasion de faire de la formation, d’échanger nos points de vue sur les fondements de notre projet d’étudiants communistes, notre vision de la société et de sa transformation. » Ils sont également engagés dans une campagne nationale, celle de la création d’un revenu étudiant. « Ça nous distingue d’autres organisations de jeunesses qui demandent un RSA jeunes ; nous pensons qu’il faut aller plus loin et instituer un véritable revenu étudiant parce qu’on apprend moins bien quand il faut travailler pour payer ses études et que l’avenir du pays dépend aussi du niveau de qualification de sa jeunesse. » Les étudiants communistes font signer une pétition sur ce thème pour engager le débat dans toutes les universités françaises et faire grandir cette revendication.
61,5%
C’est le taux de détresse psychologique relevé par l’université Grenoble-Alpes après une enquête réalisée en décembre 2020 auprès de 13 000 étudiants. Les élèves étrangers ainsi que les étudiants de première année sont particulièrement touchés.
Repas à un euro
L’une des grandes annonces gouvernementales. Qui témoigne de la détresse étudiante. Utile, mais pas mirobolant : le plat à emporter à un euro, ce sont souvent des sandwichs ou une barquette de pâtes.
Horaires Covid
A l’automne dernier, les personnels du Crous travaillant en présentiel avaient bénéficié d’une réduction de leur temps de travail de façon à se protéger du virus, de 38 à 25 heures hebdomadaires. Cette disposition a été remise en cause à compter du 20 janvier. Décision contestée par la CGT dans le contexte de l’apparition des variants. Les personnels des Crous étaient en grève le 25 janvier.La plateforme nationale « petit commerce » a aidé les commerçants dont les libraires (121 inscrits à Grenoble) en lançant des bons d’achats. Les clients ayant acheté des bons d’achats à tel ou tel commerce ont aidé les trésoreries des librairies fermées.
1000 kgs de produits alimentaires
C’était le 22 février. Le collectif Génération précarité avait organisé une distribution de produits de première nécessité. Une tonne de produits a été distribuée dans la journée. « Dans ma cité U, le Crous avait donné l’information sur cette distribution, il y avait la queue et il n’y en a pas eu pour tout le monde », témoigne Ema Pointet. Plus de trois cents étudiants ont bénéficié de cette initiative de solidarité.

Crous, les emplois perdus des étudiants
Parmi les emplois disparus qu’occupaient les étudiants pour financer leurs études, ceux des œuvres universitaires.
« Le repas à un euro, c’est bien, mais comment font les étudiants quand ils ne peuvent pas payer leur loyer ? » Huseyin Ozdemir, secrétaire du syndicat CGT des personnels des œuvres universitaires, ne manque pas une occasion d’affirmer son soutien aux étudiants. C’est que les agents sont par nature en relation constante avec eux. Non seulement comme usagers du service public pour lequel ils travaillent, mais aussi comme collègues de travail.
« Les Crous emploient des étudiants comme vacataires, plus de deux cents pour le Crous de Grenoble, explique-t-il, or ces emplois étaient gelés : la réduction d’activité liée à la crise sanitaire a été utilisée par les directions pour redéployer le personnels des restos U vers les cités U, ce qui a réduit d’autant le nombre d’heures de travail disponibles pour des étudiants ».
Travailler pour financer ses études
Une situation qui a évolué. Le syndicat a en effet obtenu que les embauches d’étudiants ne soient plus comptabilisées comme faisant partie des agents des Crous dont le nombre est plafonné à 12 721 au niveau national. « Nous allons pouvoir embaucher 5 à 600 étudiants dans les œuvres universitaires, au niveau national ». De même qu’une soixantaine de postes d’assistantes sociales vont être créés.
C’est dire l’ampleur des besoins, même si l’embauche supplémentaire d’étudiants à temps partiel ne compensera ni la difficulté à suivre ses cours dans des facs qui restent fermées ni la disparition des emplois précaires qui permettaient aux étudiants de financer leurs études et leur logement. Ne compensera pas non plus les absences d’agents liées à la crise sanitaire.
Tandis que les étudiants peinent à envisager leur avenir, les œuvres universitaires parviennent difficilement à les accompagner au quotidien.

« Le patient mériterait mieux »
Le docteur Nicolas Ollivrin, psychiatre, nous fait part de son vécu dans la crise sanitaire que traverse le pays.
TA : C’est dur pour tout le monde, plus encore pour les jeunes et les étudiants ?
Nicolas Ollivrin : J’observe une forte angoisse chez les étudiants qui me consultent. Elle résulte du contexte, de l’absence de perspectives et de l’incertitude. Incertitude source d’angoisse, qui nécessite une adaptation permanente ; c’est cause de grandes fatigues, voire de dépressions. Rarement dans l’histoire, une telle incertitude a été observée, notamment pour les jeunes.
Question de moyens, aussi. Un étudiant est venu me voir hier. Je l’ai orienté vers un service universitaire. Il m’a répondu : “je n’y accède pas”, trois mois d’attente pour un rendez-vous. Je n’ai jamais vu ça.
Les gens que je reçois sont dans des situations moins lourdes que les patients des hôpitaux. Cela dit, lorsqu’un patient me consulte, y compris dans un état difficile, les services hospitaliers le refusent ensuite, considérant qu’il est déjà pris en charge. Conséquence de la saturation de l’hôpital psychiatrique.
Quels sont vos souhaits pour que la psychiatrie puisse faire face à la crise sanitaire ?
N.O. : Nous devrions pouvoir travailler différemment, dans un format « hôpital de jour ». Un cabinet qui regrouperait psychiatres, psychologues, infirmiers, psychomotriciens, kinés… pour une prise en charge globale des patients. Nous ne sommes pas accompagnés ni encouragés dans cette voie. Cela demanderait du temps et l’accord de l’agence régionale de santé. Or nous sommes plus surveillés que soutenus. Un décret du 27 novembre dernier prévoit par exemple que les médecins peuvent être déconventionnés (leurs patients privés de remboursement) pendant trois mois sur simple décision de la CPAM.
Aujourd’hui, la psychiatrie fonctionne avec d’un côté l’hôpital pour la prise en charge les psychoses graves et de l’autre la psychiatrie de ville qui s’occupe des névroses, des dépressions. Globalement la psychiatrie souffre d’un manque de moyens et d’investissements depuis plus de vingt ans. A l’hôpital, souvent le travail n’est pas fait, faute de personnel notamment. Je me retrouve avec des patients qui devraient relever de l’hôpital.
En psychiatrie libérale, nous ne sommes pas assez nombreux. Trop souvent, ce sont les médecins généralistes qui doivent faire face, mais ce n’est pas le même soin.
Les médecins, les psychiatres et les hospitaliers font au mieux, rendent service, mais le patient mériterait mieux avec une vraie psychiatrie de secteur et des centres médico-psychologiques.
Propos recueillis par Edouard Schoene
« En 2005, le ministre Douste Blazy a ignoré une étude parlementaire sur l’évaluation des pratiques psychiatriques. Cette étude montrait que les thérapies comportementales cognitives traitaient efficacement des troubles hors psychoses, à l’inverse de la psychanalyse. Cette étude classée sans suite, les thérapies comportementales ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale, ce qui entraîne la surconsommation de médicaments psychotropes. En France, le préventif n’est pas valorisé ».
Docteur Ollivrin