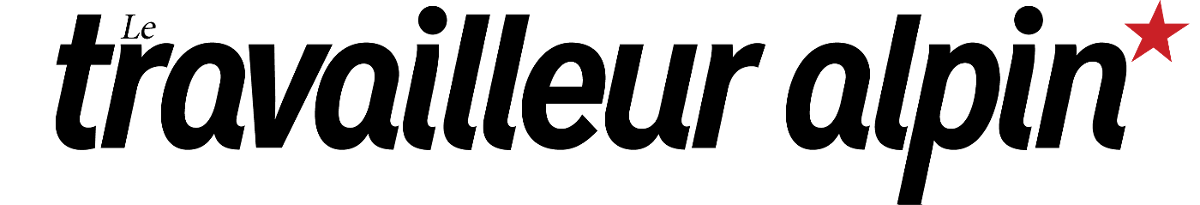Amiante. Le scandale du Pont-de-Claix
Par Simone Torres
/
Au Pont-de-Claix, une entreprise de la plateforme chimique, Choralp. Les salariés y ont été exposés à l’amiante. Plus encore, le poison a été utilisé après son interdiction. Le mépris pour la souffrance, la maladie, la mort. Avec la CGT, des salariés ont relevé la tête. Et entendent obtenir dignité et réparation. La justice peine toujours à boucler le dossier.

Il n’est pas nécessaire d’avoir manipulé de l’amiante pour être malade, il suffit d’en respirer. Les fibres inhalées pénètrent le poumon et provoquent un cancer. Si la fibre traverse le poumon, elle crée une irritation à sa surface qu’on appelle plaques pleurales. C’est le cas le « moins grave », mais il faut vivre avec l’angoisse du déclenchement de la maladie susceptible de survenir à tout moment : le cancer peut tuer en quatre mois. Si les irritations se calcifient, on perd tout doucement ses capacités respiratoires et on meurt étouffé.
L’amiante, c’est un matériau bon marché : un euro le kilo. « Sur notre site, il y avait de l’amiante partout et notamment dans la salle d’électrolyse parce qu’on avait un procédé de production de chlore à base de diaphragmes amiante. Diaphragmes qu’on devait recharger en amiante et dont on plongeait les anodes dans des bacs avec solution d’amiante. Les patrons nous expliquaient que comme c’était une solution humide, ce n’était pas dangereux par rapport à la sèche. Ce qu’ils ne disaient pas c’est que la solution finit par sécher. Les électriciens, par exemple, intervenaient sur les palans d’imprégnation tous les jours, sans masque, sans rien, puisqu’ils ignoraient le danger, avec les gants en cuir, pour enlever les fibres d’amiante qui montaient et qui s’étaient collées sèches sur les coffrets électriques », expliquent les syndicalistes CGT de la plateforme chimique du Pont-de-Claix qui ont constitué les dossiers. Jamais un décret n’a fait de distinction entre amiante sèche ou humide…

La loi interdisait l’utilisation d’amiante à partir du premier janvier 1997 et, pour les sociétés qui avaient des difficultés à trouver un matériau de remplacement, prévoyait la possibilité d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2001. Dans le cas de Chloralp, entreprise de la plateforme chimique, le responsable sécurité expliquait en septembre 2001 devant le comité d’entreprise qu’il négociait une nouvelle dérogation avec le ministère du Travail. Il annonçait dans un document officiel daté et signé « qu’il constituait un stock stratégique de 14 tonnes d’amiante pour avoir une réserve suffisante pour passer l’année 2002 sans problème ». « Ils se sont dit vu qu’on en a déjà empoisonné des milliers, un peu plus, un peu moins… l’intérêt de l’entreprise, l’argent avant tout, quitte à continuer à empoisonner les salariés », constatent les syndicalistes.
Gratter les fibres d’amiante au tournevis, sans protection aucune
Pourtant, au même moment, une brochure est diffusée pour expliquer comment gérer le risque amiante… « Sauf qu’ils continuaient à utiliser l’amiante ! On a trouvé ça bizarre et en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, on a demandé à l’inspecteur du travail s’il y avait vraiment une dérogation. Il s’étonne, on explique, on fait venir l’inspection de travail qui fait un compte rendu officiel en mars 2005 constatant l’utilisation des bouillies d’amiante et rappelant que depuis 1er janvier 2002, il n’y a plus de dérogation. Ce que la direction reconnaît. On a donc décidé de monter un dossier de demande de classement amiante ». Classement nécessaire pour que les salariés qui ont été exposés puissent bénéficier de l’allocation de cessation d’activité anticipée des travailleur de l’amiante.
« Il a fallu aller chercher le maximum d’informations et de traces écrites possible, mobiliser les salariés et les camarades pour les avoir, parce que sinon personne ne nous les donnait, constituer le dossier sans que la direction le sache. Ça a pris presque trois ans, on n’était qu’un petit groupe au courant, déterminé à aller au bout. La difficulté est de convaincre les salariés de témoigner des actes de travail exécutés, pour montrer la réalité de leur vécu. Ça n’est pas toujours facile, certains ont peur d’avoir des problèmes. Nous avons réuni des informations précises au point de pouvoir dire l’heure, le lieu et la quantité d’amiante utilisée ». Et puis il faut constituer les dossiers, un véritable parcours du combattant, ne serait-ce que pour accéder aux dossiers médicaux.
Le classement a été obtenu, une belle victoire. Mais le combat ne fait que commencer. « Maintenant ce qu’on veut, c’est voir les patrons à la barre, ceux qui nous ont empoisonnés, venir répondre de leurs actes. » Le poison a été utilisé alors qu’il était interdit.
Car l’amiante ne se résume pas à des départs en cessation d’activité anticipée pour des gens en sursis dont la maladie n’est pas encore déclarée. L’amiante c’est 130 morts à Roussillon, 70 à Jarrie, 50 au Pont-de-Claix. On ne parle pas des malades. Ni du reste de la France.

Amiante : l’insupportable « temps de la justice »
Quatre ans après le dépôt de plainte, l’enquête judiciaire n’a pas abouti. L’avocat des victimes en appelle à l’opinion publique.
L’accusation est grave : être responsable de la maladie et de la mort de salariés par l’utilisation d’une substance interdite, l’amiante. Dès lors, comment comprendre que l’enquête n’ait pas connu d’avancée substantielle depuis le dépôt de plainte, en 2013 ?
Flavien Jorquera, avocat des plaignants de la plateforme chimique du Pont-de-Claix, comprend mal ce délai. Le dossier est certes complexe et la justice manque cruellement de moyens. Mais quand même.
Des « dossiers amiante », il en est de toute sorte. Celui du Pont-de-Claix est particulier. « Nous avons des faits clairs, reconnus, avec des dates précises et des gens qui étaient présents lors de l’utilisation illicite de l’amiante. » Les faits ont été constatés, par l’inspection du travail, notamment.
Des faits reconnus, des dates précises
Ces derniers mois, l’instruction semble avoir bougé. Maître Jorquera ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec l’intervention d’Annie David auprès de la ministre de la Justice, en septembre dernier. Et il appelle à ce que le maximum d’informations soit communiqué sur cette affaire où la santé des ouvriers a été mise en cause par une violation délibérée de la loi.
Maître Jorquera soulève un autre aspect du dossier. « L’argument de l’importance de l’indemnisation n’est pas recevable, ni juridiquement ni moralement, dit-il, ce serait comme si l’on disait à la victime d’un viol qu’on ne poursuit pas son violeur parce que ça lui coûterait trop cher de l’indemniser ». On n’imagine pas que la justice puisse se montrer sensible aux conséquences financières de ses diligences.
Reste qu’aujourd’hui l’addition se paie en maladies graves et espérance de vie amoindrie, avec ce que cela signifie d’anxiété. A ces victimes, la justice doit une réponse.
Les faits
L’utilisation de l’amiante est interdite depuis 1997. Le décret prévoyait des possibilités de dérogation jusqu’au 31 décembre 2001. Chloralp, société de la plate-forme chimique du Pont-de-Claix, a continué à employer de l’amiante mais s’est en plus constitué un stock de quatorze tonnes pour s’en servir après 2001.
La plainte
Elle a été déposée au parquet le 24 décembre 2013. Selon maître Flavien Jorquera, avocat des victimes de l’amiante sur le site de Pont-de-Claix, les infractions d’homicide par imprudence, blessures par imprudence, administration de substances nuisibles et mise en danger de la vie d’autrui sont constituées.
L’enquête
Dix mois après le dépôt de plainte, les victimes et le syndicat CGT se sont constitués partie civile, ce qui entraîne la nomination d’un juge d’instruction. Juge qui a entendu les plaignants le 10 mars 2016. « Dix-huit mois plus tard et jusqu’à une période récente, nous avions l’impression que rien ne se passait », témoigne Flavien Jorquera. Une enquête a été diligentée. Si le dossier n’évolue pas, la chambre d’instruction sera saisie début 2018. Maître Jorquera a demandé l’audition du président de Chloralp, du directeur général de l’entreprise, de l’ingénieur responsable de l’atelier chlore, du directeur technique, responsable des procédures hygiène et sécurité et du médecin du travail.

Deux mandats de sénatrice aux côtés des victimes
Des années de travail parlementaire, la confrontation avec des drames humains. Des avancées, aussi.
Elle venait d’être élue sénatrice de l’Isère. C’est alors qu’Annie David s’est emparée du dossier de l’amiante, qu’elle a suivi tout au long de son mandat. Une bataille parlementaire acharnée qui commence à Brignoud, avec la fermeture du site Atofina et les difficultés des salariés à constituer leurs dossiers juridiques de maladie professionnelle. Elle devient peu à un peu la référente amiante de l’Isère car peu de parlementaires isérois se sentent alors concernés.
Au parlement, devant les usines
Un dossier qu’on ne lâche pas une fois qu’on l’a ouvert, explique-t-elle, car « on est chaque fois face à des drames humains et on ne peut que se sentir lié aux salariés rencontrés ».
Batailles au Sénat, notamment lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mobilisations devant les usines, réunions avec les comités d’entreprise, interpellation des préfets, des ministres, courriers… elle a travaillé dur et son action, qu’elle n’évoque qu’à peine, celle des avocats devenus eux aussi spécialistes, et « la pugnacité de certains syndicalistes, notamment ceux que j’ai rencontrés à la CGT » a permis de progresser.
« On a eu des succès, on a eu des défaites, mais de belles victoires qui récompensent de tous les efforts fournis ». Une inquiétude pourtant, « la justice est aujourd’hui plus frileuse à reconnaître ces dossiers ». Tant d’injustices demandent encore pourtant réparation.
Préserver les bénéfices ou investir dans la recherche scientifique
Les dangers de l’amiante sont connus depuis le tout début du XXe siècle. Les premières réglementations datent des années 1930, au Royaume-Uni. Pourtant, l’amiante ne sera totalement interdite en France qu’en 1997. Et si l’utilisation de l’amiante est aujourd’hui prohibée, il existe encore de nombreux bâtiments qui en contiennent, et parfois sans que les salariés le sachent. Mais, comme aujourd’hui avec le bisphénol A ou le glyphosate, de nombreux industriels, avec la complicité de certains scientifiques, ont tout tenté pour accréditer le mythe d’un matériau irremplaçable. Comme toujours, question de coûts et d’investissements dans la recherche de solutions alternatives. Mais pour financer la recherche, il faut avoir envie de préserver la santé des salariés. Ce qui n’est pas dans l’air du temps.
Une histoire de gros sous
ATMP : c’est la branche accidents du travail — maladies professionnelles de la sécurité sociale. Lorsqu’une maladie professionnelle est reconnue, c’est l’ATMP qui indemnise le salarié. Cette branche est financée par l’entreprise : le Code du travail stipule encore que les entreprises doivent assurer la sécurité et la santé des salariés.
Cela a donc un coût pour les entreprises. Elles sont en effet redevables d’une contribution au financement de l’ATMP après chaque reconnaissance d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
Conséquence ? Evidemment l’absence de déclaration par certains employeurs.
Maladie : la banche classique. C’est elle qui indemnise les salariés victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail non déclaré en tant que tel. Phénomène reconnu au point que, chaque année, le parlement vote un transfert entre les deux branches : faire payer aux entreprises un peu de ce qu’elles ne déclarent pas. Les élus communistes demandent une augmentation de ce transfert. Réponse : « c’est vrai, mais on ne peut pas augmenter les ‘‘charges’’ des entreprises ».
Acaata : l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Même principe. Le combat des élus communistes est d’augmenter les cotisations destinées à son financement, sachant qu’un nombre important de victimes n’est pas pris en charge.