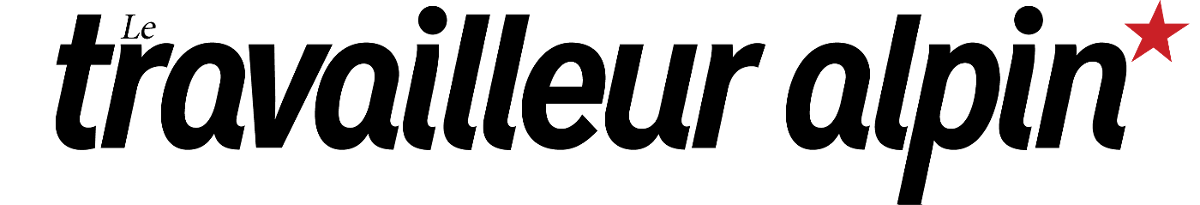Denise Meunier fête son centième anniversaire
Par Max Blanchard
/

Denise Meunier a cent ans ce 6 janvier 2018. Une belle occasion pour un bel hommage : Denise Meunier, présidente départementale de l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance, figure de la Résistance en Seine-Maritime, nous a confié le récit de ses activités pendant la seconde guerre mondiale. Communiste, résistante… un entretien que nous sommes heureux de publier aujourd’hui pour lui souhaiter un bel anniversaire.
Denise Meunier est née le 6 janvier 1918 à Paris, dans le quartier des halles, « au sein d’une famille petite-bourgeoise dont mes parents étaient les parents pauvres », dit-elle. A sa naissance, ses parents travaillaient dans un grand café parisien. Ils se sont ensuite mis à leur compte, changeant de villes à plusieurs reprises, passant par Fontainebleau puis par divers hôtels familiaux, jusqu’à Rouen.

« Je fis ma scolarité à Rouen jusqu’à l’école primaire supérieure (équivalent collège) jusqu’à mon brevet. Comme mes parents étaient de ressources modestes, j’ai passé le concours de l’Ecole normale où j’ai été interne durant trois ans ( de 1935 à 1938). C’était un régime sévère, militaire. J’y suis restée jusqu’à l’âge de 20 ans. C’est à cette période que j’ai commencé à m’intéresser à la société. Je me suis initiée à la littérature, à l’histoire. Il faut dire que, dans l’école, il était interdit d’introduire des journaux et des brochures. J’étais parmi les rebelles. »
L’entrée en guerre
« En 1938, j’ai obtenu mon brevet supérieur et j’ai occupé mon premier poste dans le département à la rentrée 1938/1939. Je suis restée trois mois seulement à ce poste. Puis j’ai été malade. La directrice de l’Ecole normale m’a fait nommer à Dieppe. »
A la rentrée 1939/1940, c’était “la drôle de guerre”. « Mes parents étant âgés et seuls à Rouen, je suis nommée à Rouen dans une école primaire d’un quartier populaire. J’y fis la connaissance de Suzanne Constantin » (qui sera déportée à Auschwitz où elle décédera).
Puis c’est l’invasion allemande. Tous les services administratifs rouennais (dont l’Inspection académique), qui sont sur la rive droite de la Seine déménagent sur la rive gauche (si les ponts sautent, il leur sera plus facile de se replier).
L’exode
Rouen est bombardée. Les écoles sont fermées. Les gens fuient. « Mes parents seront parmi les derniers à quitter Rouen, avec le désir d’aller dans de la famille à une douzaine de kilomètres de Rouen. Juin 1940 : nous partons à pied. »
Les Français, en partant, avaient mis le feu aux réservoirs pétroliers de bord de Seine. « La chaleur était telle que l’on ne pouvait passer ni d’un côté ni de l’autre du fleuve. Les Allemands jetaient des bombes incendiaires. Nous sommes arrivés au passage du bac où de nombreuses voitures étaient abandonnées. Nous nous abritions où nous pouvions : maisons, granges, grottes… Nous nous sommes retrouvés à Bourg-Achard, de l’autre côté de la Seine où étaient cantonnés des soldats français revenant de Bitch en Lorraine. Ils ont partagé leur pain avec nous. Le lendemain, les officiers ont rassemblé les soldats et dit qu’ils reviendraient les chercher avec des camions. Ils sont partis en voiture, mais ne sont jamais revenus. »

Les Allemands continuaient à avancer. « On ne pouvait plus aller dans notre famille. Nous étions poussés par les mitraillages, l’avancée des troupes allemandes. On s’est tous mis en route. Petit à petit les soldats se sont dispersés. Seuls trois ou quatre sont restés avec nous. On ne trouvait plus rien à manger car on était les derniers : tout avait déjà été pris, pillé. Seuls quelques paysans à qui il restait de la nourriture nous faisaient payer, et souvent cher. C’était un beau mois de juin. Il faisait chaud : on partait tôt ; on s’arrêtait quand il faisait trop chaud. Parfois les avions nous mitraillaient. On continuait vers le sud. »
La famille parvient à cinq kilomètres environ d’Alençon, dans l’Orne, au Sud de la Normandie. « Nous nous sommes réfugiés dans une grange. Ma mère a réussi à acheter deux canetons et des navets à un garçon de ferme. Des escadrilles de bombardiers sont venues déverser leurs bombes sur Alençon par deux vagues successives. Il y a eu un vrai carnage (des gens attendaient des trains qui ne viendraient jamais à la gare, qui fut entièrement détruite). Tôt le matin, nous avons entendu des moteurs : c’était les troupes allemandes qui passaient. Les soldats français qui étaient avec nous se sont débarrassé de leur uniforme, ont récupéré des tenues civiles et se sont dispersé. Nous avons alors rebroussé chemin, retournant sur Rouen : ce n’était plus la peine de continuer car les Allemands nous avaient rejoints et dépassés. »
Cet aller-retour avait duré une dizaine de jours au total.
L’occupation
« Nous avons retrouvé Rouen bien abîmée par les bombardements. Nous sommes rentrés à la maison. C’étaient les vacances scolaires. Pour la rentrée 1940/1941, j’étais à Dieppe. La vie reprend sous la férule des Allemands. On était soumis à l’administration allemande et sous l’autorité du ministre de Vichy. Il y avait des bombardements alliés car les Allemands étaient sur la côte (mur de l’Atlantique avec blockhaus, barbelés, et sentinelles). »
Par crainte des gaz, des masques sont distribués aux élèves. Il n’y a plus de liberté de circulation. « J’allais voir mes parents à Rouen toutes les semaines par le train et j’étais soumise chaque fois à de nombreux contrôles. »
« A cette rentrée, une de mes collègues institutrice dans la banlieue Rouen, qui faisait partie de mon groupe de rebelles à l’EN, me présenta au départ du train un professeur de philo nommé à Rouen, Valentin Feldman. Je saurai plus tard que c’était un communiste, muté de Paris. Nous nous sommes liés d’amitié. On lisait ensemble la presse de l’époque à Dieppe. Il était en confiance avec moi et m’a passé des écrits “subversifs”. J’ai compris qu’il était dans la Résistance, en liaison avec le réseau du musée de l’Homme. »
Résistance
Au printemps 1941, Denise Meunier entre dans la Résistance. « Les consignes de sécurité étaient très strictes : nos relations se sont distendues. A la rentrée, une collègue enseignante de la région de Dieppe déjà dans la clandestinité – Marie-Thérèse Lefèbvre – est venue me voir. Elle cherchait une planque pour une imprimerie clandestine et elle s’est installée chez moi. Nous avons défini un plan de protection et elle s’est mise à tirer pendant mes heures de classe les tracts du “Front national de lutte pour l’indépendance de la France”. »
« Je l’ai quelquefois accompagnée pour livrer des paquets de tracts qu’elle diffusait. Je vendais à mes collègues des bons édités par le FN pour financer des colis et soutenir notre activité. Elle est restée chez moi jusqu’à décembre 1941. Il commençait à y avoir des risques, elle devait changer de planque. J’avais une collègue qui était partie chez ses parents à Poitiers soigner sa dépression et m’avait laissé les clés de son appartement : c’est là que nous avons planqué la ronéo. »
(Valentin Feldman fut radié de l’éducation nationale car juif. « Parti à Rouen dans clandestinité (je l’ai revu une ou deux fois quand il apportait des stencils ou transmettait des infos à mon imprimeuse), il s’occupait de liaisons et de presse. » Il fut arrêté par erreur à la place d’un autre, emprisonné, condamné à mort, puis fusillé au Mont-Valérien en juillet 1942. Marie-Thérèse Lefebvre s’est fait prendre – dénoncée –. « Elle m’a innocentée ». Internée dans plusieurs camps français, puis déportée à Flossenburg où elle fut affectée à un kommando de l’usine, puis à Ravensbrück. Elle en est sortie vivante)

« Durant les vacances de Noël 41, alors que j’étais chez mes parents, nous avons eu une perquisition policière car ils avaient trouvé trace du passage de Marie-Thérèse Lefèbvre chez moi. La police française est venue fouiller chez mes parents. Celui qui visita ma chambre ne fit pas trop de zèle. Heureusement car j’avais des brochures cachées sous le matelas. »
Denise Meunier et sa mère sont alors convoquées au commissariat pour un interrogatoire.
« La police de Dieppe me donna rendez-vous à la gare de Dieppe pour une fouille dans mon appartement où j’appris qu’une souricière avait été installée. Là, nouvelle perquisition : ils ne trouvèrent rien. Je suis restée sous surveillance et mon courrier fut régulièrement ouvert. Je me suis donc abstenue de toute activité et j’ai repris la classe. »
Août 1942. « Je suis sous surveillance, isolée. Il y eut une tentative de débarquement canadien à Dieppe. Nous sommes restés à l’abri dans une cave. Il y a eu des batailles de rues toute la journée. On nous a finalement fait sortir pour assister au défilé des prisonniers canadiens. ‘Ne vous en faites pas, on reviendra !’, nous lançaient ces derniers. »
Rentrée 1942/1943, Dieppe. Les Allemands ont renforcé leur défense sur la côte suite au débarquement canadien. « Certaines écoles sont réquisitionnées par leurs troupes, notamment la mienne : les élèves et les enseignants du quartier du Polet (quartier de pêcheurs). » Les élèves furent accueillis dans le pays de Bray et les enseignants également, hébergés par des paysans à côté de Neuchatel en Bray.
« Là je reçois la visite de camarades FTP : on me propose de reprendre des activités tout en restant institutrice et agent de liaison. Je faisais la liaison avec l’état-major FTP à Rouen du groupe de Neuchatel en Bray. J’étais dans une semi-illégalité car toujours institutrice. J’étais également chargée de faire la tournée des secrétaires de mairie pour récolter des tickets de ravitaillement pour les réfractaires du STO et les gens de la Résistance. Pour ceux du pays, je m’appelais Michelle. Je convoyais également des jeunes locaux qui voulaient entrer dans la Résistance quand ils étaient requis au STO. Je visitais aussi ceux qui nous soutenaient financièrement. »
Décembre 1943. « Je me suis fait prendre dans le cadre d’une descente de police en gare de Rouen où je portais une mallette avec des armes et des vêtements. Je n’ai pas pu m’échapper. Je fus emmenée au commissariat. J’avalais précipitamment et discrètement un message que j’avais gardé imprudemment sur moi. J’ai été interrogée durant une semaine au commissariat central de Rouen. Durant ce temps, le chef de groupe a fait l’erreur de rentrer chez lui, puis de retourner récupérer son vélo à la consigne de la gare : il a été arrêté. Interrogé, il a parlé sans être torturé : je lui en ai voulu. Mais peut-être y‑a-t-il eu torture morale vis-à-vis de ses proches ? Il m’a chargée, alors que j’ai toujours soutenu que je n’étais pas au courant de ce que je transportais. Ils n’ont jamais su que j’étais communiste. Sept membres du groupe sont ainsi tombés : trois filles et quatre hommes. J’ai été ensuite emprisonnée à la prison Bonne-Nouvelle de Rouen. Les femmes étaient regroupées dans la même cellule durant la période, de décembre 1943 à avril 1944. »
Denise Meunier est libérée fin avril 44. « J’ai réussi à sortir grâce à la conjonction de plusieurs éléments », analyse-t-elle. Elle cite tout d’abord « la solidarité des camarades qui m’ont innocentée », mais aussi « le fait que j’aie été arrêtée par la police française : Ali, responsable régional de la brigade spéciale anti-terroriste, équivalent de la milice (comme Touvier), était inquiet pour son avenir, c’était le moment de l’offensive soviétique. Des trois filles, celle qui avait des antécédents n’a pas pu y échapper. Par contre les deux autres, dont moi, nous nous sommes toujours prétendues innocentes. Les faire libérer ne lui coûtait rien et serait à sa décharge si les choses tournaient mal ». Denise Meunier rend également hommage à « la pression de nos mères » et n’oublie pas « le bombardement anglais qui a détruit le siège de la Gestapo où étaient nos dossiers des interrogatoires qu’elle avait réalisés : plus de trace. On n’a jamais été torturées car ils ne pensaient pas pouvoir tirer des renseignements de notre part. »
Les deux femmes sortent de prison. A la Libération, Ali fut reconnu, arrêté et jugé. « Il demanda notre témoignage à décharge. Nous n’y sommes pas allées. »
La Libération
Denise Meunier rentre chez elle et reprend le travail. « J’étais nommée aux environs de Rouen. » Puis ce fut le débarquement. Les écoles furent fermées. « Je fus alors contactée de nouveau par le PC et les FUJP (Forces unies de la jeunesse patriotique, qui coordonnait toutes les associations de jeunesse résistantes). Je devins illégale. On m’avait envoyée dans un grenier d’une ferme en bordure de la Seine pour être imprimeuse. J’avais pris le pseudo de Françoise Vaillant, en hommage à Vaillant-Couturier. J’ai assisté à la débâcle des Allemands qui abandonnaient tout dans leur fuite. »
« J’ai rejoint l’état-major de la Résistance et du PC. Nous étions installés dans les locaux de la kommandantur. J’aurais pu reprendre un poste à l’Education nationale, mais on m’a demandé de prendre un poste dans l’organisation de la Résistance. J’ai remplacé le responsable départemental de l’UJFP (Union des jeunes filles patriotes). J’étais à la fois déléguée JC, FUJP, JFP. J’ai été responsable départementale en 44/45. »
Le journal L’Avenir normand devenant quotidien, Denise Meunier en assure la rédaction en 1945. « J’ai dû notamment faire des reportages sur la reconstruction, moi qui ne connaissais rien aux termes techniques ! »
Retour à l’enseignement
« Puis j’ai repris mon activité à l’éducation nationale (mariée, j’attendais un enfant). Je suis devenue rédactrice dans les services de l’enseignement technique. A la rentrée 1948, retour à l’enseignement : je n’ai pas obtenu de poste à Rouen et j’ai dû m’exiler à la campagne où j’étais en même temps secrétaire de mairie. Je suis restée près de Jumièges jusqu’en 1953. Puis nommée à mi-chemin, à Quevillon, de 1953 à 1957. Changement pour Canteleux (près de Rouen) de 1957 à 1962. Là, j’ai repris mes activités syndicales et politiques. »
Grenoble
« En 1962, mon mari, qui est fonctionnaire, est nommé à Grenoble. Je le suis. J’enseigne à Grenoble jusqu’en 1969, puis de 1969 à 1974 à l’école Paul-Bert à Saint-Martin-d’Hères. C’est là que j’ai pris ma retraite ».
Le 24 mai 2014, Denise Meunier, présidente départementale de l’Association nationale des combattants de la Résistance, recevait les insignes de Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur.