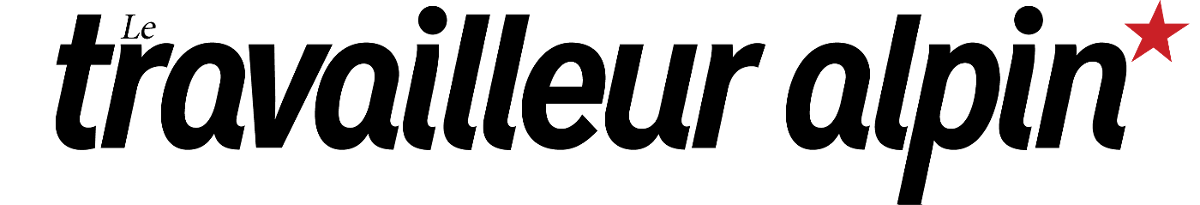François Pepelnjak : une vie de convictions
Par Max Blanchard
/
François Pepelnjak s'est éteint le 26 octobre 2017. En 2005, il avait répondu à nos questions sur la Résistance et sa déportation. Il portait le matricule n° 31 591. Entré à la mine à 14 ans, François Pepelnjak a été un militant communiste tout au long de sa vie. Entretien, réalisé en 2005.

François Pepelnjak est né le 14 janvier 1924 à Tuquegnieux (Meurthe-et-Moselle) de parents d’origine yougoslave, arrivés en France en 1923. Sa mère est enceinte, son père employé dans une mine de fer. Quand sa mère accouche, c’est le départ pour le Pas-de-Calais, son père préférait travailler dans une mine de charbon. Ils arrivent à Lens en avril 1924.
Il a effectué sa scolarité à Lens et passé son certificat d’études pendant les grèves de 1936. Il a bénéficié de la loi sur l’école jusqu’à 14 ans : pendant deux ans il est resté à la maison en attendant d’avoir l’âge requis pour travailler.

Il rentre à la mine en 1938 à 14 ans (la compagnie des mines était une société privée). La possibilité était offerte aux jeunes galibots (qui devaient avoir 15 ans et 3 mois pour pouvoir en bénéficier) d’avoir une formation. La sienne lui est refusée, à cause de son activité politique. Il a commencé par trier le charbon. Puis à 15 ans et 3 mois, il est descendu et a été affecté à l’accrochage des wagonnets, jusqu’à la guerre.
Il est entré aux Jeunesses communistes à 14 ans. Entre l’obtention de son certificat d’étude et ses 14 ans, il allait au siège des “Amis de l’Union soviétique” (à Lens) où il jouait au billard russe et préparait les paquets de matériel pour les différentes communes du département, et participait à des quêtes pour l’Espagne républicaine.


La guerre
Puis c’est la déclaration de guerre, la dissolution du PCF.
Le Pas-de-Calais est occupé par les Allemands en mai 1940. La région est régie par des lois allemandes. Le territoire est annexé et rattaché à la kommandanture de Bruxelles.
« On se voyait comme on pouvait : il y avait peu de cinés ouverts. On sortait souvent le dimanche. Les cités autour des puits de mine regroupaient quelque 1200 mineurs. On se rencontrait souvent dans les bois séparant les cités. Les bals étaient interdits.
En janvier/février 1941, alors que je travaillais dans le jardin extérieur à la cité, je vois un copain. Nous discutons des coups de main effectués dans le département et pensons qu’il faut faire quelque chose. Lui travaillait au génie civil : il y avait un grand entrepôt stockant le bois de coffrage.

C’est comme cela que cela a commencé : on a commencé à recruter dans les milieux yougoslaves. Nous avons constitué un groupe de treize membres (dix Yougoslaves, deux Italiens et un Polonais) dépendant de la MOI. Nous devions nous débrouiller par nous-mêmes. Nous réalisions des mots d’ordre et des papillons que nous collions. Nous distribuions des tracts, faisions des inscriptions sur les murs, accrochions des drapeaux rouges…

Puis c’est la grève des mineurs de juin 1941 : vingt-quatre puits sont concernés. On allait de l’un à l’autre pour maintenir le moral. 400 mineurs ont été déportés de tout le bassin. Cela a duré plus de 15 jours.
Le 22 juin 1941, les Allemands attaquent l’URSS. On continue notre action. On crée les bases d’une organisation de masse plus large avec le Front national, pour l’élargissement de la lutte avec le plus grand nombre. C’est la création d’un groupe FN vers septembre 1941.
L’action
Un groupe d’adultes FTP a attaqué la poudrière de Beaumont : plus de 1500 tonnes d’explosifs ont été récupérés. Réparti dans groupes du département. A partir de là, ça a pété de partout dans le département.
On nous a demandé de préparer des exploseurs, d’en bricoler. J’en avais la charge. J’en ai fait quatre, en ai gardé un pour nous. Le premier groupe qui attaque est constitué de deux copains d’Avron qui posent les explosifs près d’une voie. Rien n’explose, ils s’approchent pour voir, tout pète à ce moment-là. Bilan : un tué et un blessé, qui sera fusillé quelques jours plus tard.
Le groupe FN tombe d’abord, puis quelques jours plus tard mon groupe de treize, dénoncés par un collabo. Tout le groupe a été arrêté en même temps le 2 décembre 1941 par la police française. Nous sommes enfermés dans un cachot à Lens, où nous subissons des coups et des interrogatoires. Puis les Allemands nous récupèrent et nous emmènent en camion à la prison de Douai (toute une aile était réservée aux Allemands, plus un étage dans le reste de la prison. C’est dans ce dernier élément que nous étions). Dans des cachots individuels au milieu des droits communs, qui eux étaient à dix par cellule.

J’y suis resté jusqu’à Noël. On communiquait entre nous par les tuyaux du chauffage central. Après cette date, nous avons été dispersés dans le quartier allemand. Il n’y a plus eu de communication entre nous. J’ai passé sept mois ici. Il faisait un froid de canard. Nous avions une seule couverture. L’eau des tinettes gelait.
Au bout de sept mois, je fus libéré (alors que cinq autres étaient déportés) en juin 1942.
Seconde arrestation
Je rentre à Lens. Peu après je suis de nouveau contacté. Je participe à quelques opérations, mais sans beaucoup de moyens. Puis je suis arrêté une seconde fois en septembre 1942. Je suis pris par les Français et emmené à la prison de Béthune. Puis c’est la citadelle de Doulans, où je reste six mois, à Ecrouves (banlieue de Toul), six mois également, Nancy, puis Ecrouves de nouveau jusqu’à novembre 1943. Là, une sélection est faite, où l’on trie les gens estimés dangereux (dont je fais partie). Je suis envoyé à Vove, dans l’Eure-et-Loir, où je reste de novembre 1943 à mai 1944. C’était un camp d’étrangers où j’étais le responsable d’une baraque. Il y avait beaucoup de syndicalistes : c’était de là que sont venus les 27 de Chateaubriant.

Tous les colis étaient mis en commun dans la baraque. On avait une organisation sur le camp. Je m’occupais de l’information : on faisait une revue de presse que l’on relayait dans sa baraque. Il y avait beaucoup de républicains espagnols.
On a préparé une évasion. Pour cela, on a formé des groupes. Les jeunes devaient sortir les derniers. Quarante-deux ont pu sortir, mais ensuite la lune s’est levée, on a été obligé d’arrêter, les jeunes sont restés. Le tunnel avait été réalisé par des mineurs du Pas-de-Calais. Le 9 mai, tout le camp a été embarqué à destination de Compiègne. Nous y sommes restés quinze jours.
Le camp
Puis ce fut le départ pour Neuengamme (Nord de l’Allemagne, dans les faubourgs de Hambourg). Nous étions 2000 dans le convoi. Le voyage dura trois jours. Avant le départ, on nous avait donné du cervelas et un morceau de pain. Nous étions cent par wagon. Le pain est devenu dur. Je ne l’ai pas mangé. Nous avions très soif. Nous étions tous debout, on était obligés de se relayer pour s’asseoir. Il y avait un seul seau pour se soulager. On le vidait à travers les interstices du wagon. Cela se faisait pour l’urine, mais pas pour le reste : ça puait. Ceux qui avaient mangé avaient encore plus soif que moi. La nuit, c’étaient des cris. Cela dura trois jours et trois nuits, avec une soif et une faim lancinantes. Nous avons eu un peu d’eau offerte par des Français à la frontière.
Quand nous arrivâmes à Neuengamme, les portes du wagon furent ouvertes : une immense flaque d’eau s’étendait devant lui. On a plongé dans l’eau boueuse et bu tant qu’on a pu. On a sorti 5 ou 6 morts du wagon. C’était en juin 1944.
On nous a fait déshabiller. On nous a rasés et inspectés. On prenait les lunettes, les appareils dentaires. On nous donnait un numéro de matricule, dont le numéro figurait également sur une plaque munie d’une cordelette que l’on portait autour du cou. N° 31 591 pour moi, porté sur la droite du pantalon et sur la gauche de la veste. Un triangle rouge avec lettre “F”. Moi j’avais “YU” (pour Yougoslave).
Il y a eu un appel. Comme nous n’étions affectés nulle part, on nous a fait courir. Les retardataires étaient battus.
Il y avait un marais en cours d’assèchement : on nous y a affectés pour remblayer. Il y avait des chariots à charger et à décharger pour combler le marais, dans la perspective d’y installer l’extension de l’usine d’armes du camp. Les déblais venaient de Hambourg bombardé. Tout se faisait en courant. J’y suis resté trois semaines.
Au kommando de Bremenfarge
Puis je fus affecté au kommando de Bremenfarge (ou kommando Farge à Brême) jusqu’au 11 janvier 1945. Pour la construction d’une base sous-marine qui n’a jamais été terminée et dont les bâtiments sont encore utilisés aujourd’hui par la flotte allemande. Une réalisation aux murs très épais : le bunker Valentin en était la pièce maîtresse, c’était un monstre de béton.
J’ai profité d’un changement de vêtements (qu’on nous renouvelait quand même de temps à autre) pour gratter le “YU” et obtenir un “F” à la place (les Français étaient mieux traités).
On rentrait du commando à la nuit, sur la base de 12 h de jour et 12 h de nuit, avec repos le dimanche. Les trains arrivaient souvent le dimanche : le kommando disciplinaire devait les décharger.
J’ai fait partie de ce kommando disciplinaire : toutes les corvées en plus du travail ordinaire. A ce rythme-là, je suis arrivé au bout du rouleau et qualifié de “musulman”, un terme qualifiant ceux qui étaient hors production.
En janvier 1945, j’ai quitté le camp comme “musulman” : j’étais complètement épuisé, je ne pouvais plus me lever. On était soit destinés à l’infirmerie, soit liquidés. Pour cela, il fallait un retour au camp de base. J’ai donc été renvoyé à Neuengamme (« vous partez au sanatorium », m’a‑t-on, annoncé !). On nous a retiré toutes nos affaires et revêtus de rebuts, des loques sordides. Nous n’avions plus de numéro : seulement un chiffre écrit avec un crayon gras sur la peau. Durant tout le voyage, nous nous sommes posé des questions.
Quand nous sommes arrivés à Neuengamme : on nous a mis dans des bâtiments en dur, faits pendant qu’on était absents. Nous étions logés sans travailler, juste nourris, délaissés. On s’organise : je joue l’interprète ; le toubib français s’occupe de nous et nous fait donner des comprimés. Chaque matin, on sortait les morts.
Dans le même temps, la pression des alliés s’accentue : les Allemands sont pris sur le Rhin ; attaque des Anglais par la Hollande ; beaucoup des plans allemands sont alors compromis. Nous n’avions cependant pas d’écho de ce qui se passait à l’extérieur !
Il y a eu deux contrôles sanitaires pour essayer de recruter du personnel pour les kommandos. Le premier, je l’ai évité, mais pas le second. Le groupe est amené dans une baraque vide où il y a seulement de la paille. On devait nous envoyer en Suède. Nous y sommes restés deux à trois jours. Il y avait un accord avec la Croix-Rouge. Le comte Bernadotte exigeait que les prisonniers suédois soient rapatriés par la Croix-Rouge suédoise. Cela concernait surtout les Suédois, mais également les Français. Lors de la venue d’une camionnette, je me suis engouffré dans le véhicule avec des Suédois. On s’est arrêté dans un kommando du Nord où l’on fabriquait des accus. On a été mis dans une baraque à part. On n’a eu à manger que le lendemain. On est restés quatre ou cinq jours.
Un matin, on nous fait sortir sur la place d’appel où une masse de papiers brûlaient.

Nous sommes partis à pied. Je retrouvais un copain de Doulans. Je l’aidais à marcher. On a su alors que ceux qui ne pouvaient plus avancer avaient été brûlés dans une grange. On a pris la route avec une boule de pain. Il n’y avait que des anciens “musulmans” à moitié foutus. On marchait, suivis par les soldats. De temps en temps, j’entendais un coup de feu, mais je ne peux pas dire à quoi cela correspondait, j’étais trop préoccupé d’avancer. Si quelqu’un tombait, personne n’était assez fort pour le releve
On a passé la nuit dans la paille d’une grange. J’ai mis ma boule de pain sous ma tête et me suis endormi d’un coup. Au réveil, mon pain avait disparu. On a fait 70 km en deux jours. Le deuxième, je suis reparti le ventre vide. Nous sommes arrivés au camp de Bergen-Belsen. A 500 m de l’arrivée, un gars s’écroule : on l’a porté et tiré durant les 500 m comme on a pu ; à l’entrée, il avait le derrière en sang, mais il était sauvé !
Le camp de Bergen-Belsen était une catastrophe ! Il y avait 15 000 cadavres. 22 000 ont été enterrés. On regroupait tout ici.
Les troupes anglaises sont arrivées le dimanche 15 avril 1945 (Montgoméry). On avait dû arriver vers le 6 avril. Il y avait des baraques éventrées, des cadavres partout. Typhus et dysenterie régnaient en maîtres. C’était apocalyptique !
On a été libérés le dimanche. A partir du mercredi ou du jeudi, les SS rentraient avec chiens et faisaient lever tous ceux qui bougeaient. On nous a mis en colonne pour tirer les cadavres, les enterrer. Pendant deux jours, on n’a fait que ça.Tout ce qui pouvait marcher a été mobilisé. Le passage des cadavres tirés laissait un creux dans le chemin. On les balançait dans des fosses.
Nous n’avions pas d’eau depuis le 6 avril. On n’a eu que deux gamelles de soupe. Rien pour se laver.

Le samedi matin, plus de SS. On entendait le bruit des combats. On dormait par terre et en dehors des baraques. On avait des lambeaux de chair de cadavres sur nous. Le dimanche à 15 h, nous étions libérés : deux ou trois estafettes sont arrivées. Les hauts parleurs annonçaient : “ne craignez rien, on s’occupe de vous !” Mais le soir, rien ! On n’a eu à manger que le lundi soir : deux boîtes, porc et ration à étage (chocolat, biscuit, trois cigarettes). Ceux qui ont mangé le porc ont crié toute la nuit (hurlements, cris), et à l’aube il y avait des morts en pagaille. Le camp a dû être brûlé au lance-flamme pour assainir. Sept mille libérés sont morts !
Il y a eu de la pagaille durant quelques jours, puis du personnel est arrivé. On nous marquait des lettres sur le front avec un crayon : T pour typhus, D pour diarrhée… On nous a mis en quarantaine. Puis on nous a transportés dans les casernes alentours, installés sur de la paille et soignés. Il en mourrait quand même tous les jours. A la sortie du camp, je ne pesais plus que 48 kg.
Retour en France
J’ai quitté Belsen le 23 mai et suis arrivé en France le 25 (à mon domicile), en passant par la Hollande et Lille.
J’ai été repris aux ateliers centraux en décembre. Mais je n’y suis pas resté : j’ai travaillé deux ans à la fédération du Pas-de-Calais du PCF, puis deux ans à Paris de 1948 à 1950, au comité central du PCF comme responsable du groupe de langue immigrés yougoslaves. Ensuite, je suis resté dans le Pas-de-Calais jusqu’en 1966 où je suis venu à Saint-Martin-d’Hères ».